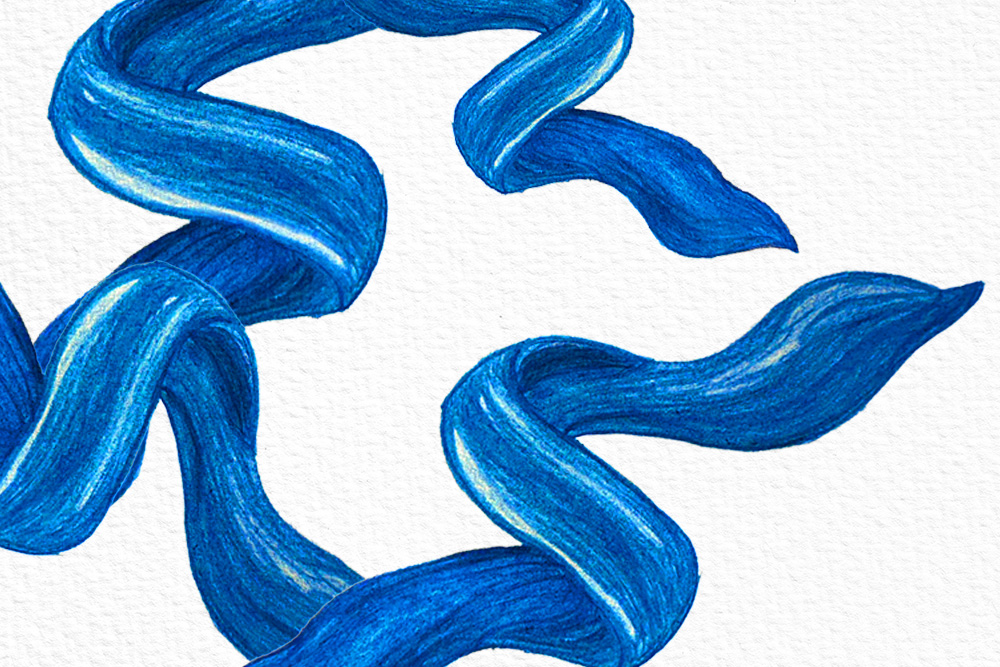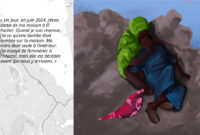Soudan : à la recherche d’un foulard perdu en pleine destruction
Suha Diab, coordonnatrice des activités de plaidoyer de MSF, raconte son retour au Soudan et sa découverte d’une ville marquée par la guerre.
L’été dernier, lorsque Médecins Sans Frontières (MSF) m’a demandé si je souhaitais retourner au Soudan, j’ai accepté sans hésiter. J’avais déjà vécu et travaillé dans ce pays lors d’une précédente affectation avec MSF, de septembre 2021 à mars 2023. J’avais passé suffisamment de temps à Khartoum pour me familiariser avec la vie locale : les vendeuses de thé, les kiosques de falafels et les conversations tardives sur les toits après le travail. C’était une ville qui m’avait tranquillement séduite, jusqu’à ce que je m’y sente chez moi.
Lorsque mon affectation au Soudan a pris fin le 31 mars 2023, j’ai laissé un sac de voyage à l’appartement de MSF à Khartoum. Je m’attendais à le recevoir peu de temps après. Il contenait deux objets qui m’étaient chers : une écharpe bleu indigo venant d’Inde, qu’une personne chère m’avait offerte des années auparavant, et que je portais à chacune de mes visites dans les projets. Il y avait aussi un sac en cuir marron avec un motif noir et blanc, un cadeau d’adieu de mon équipe soudanaise à la fin de mon affectation. Tout a été bouleversé en avril 2023 lorsque la guerre a éclaté de manière inattendue pour beaucoup d’entre nous. L’idée que la vie continuerait comme avant s’est évanouie du jour au lendemain.
Les histoires qu’on m’a racontées étaient tragiques : fuir sous les tirs, négocier son passage aux postes de contrôle, murmurer des adieux précipités ou s’aventurer jusqu’à la frontière pour mettre ses proches en sécurité.
À l’heure actuelle, près de 13 millions de personnes ont été déplacées à travers le Soudan, soit environ un tiers de la population du Canada. Près de 4,5 millions de personnes ont été contraintes de se réfugier dans des pays voisins. Des millions d’autres vivent dans des conditions précaires, exposées à des maladies évitables, mais mortelles. Ce qui a commencé comme une quête de pouvoir s’est rapidement transformé en une guerre civile. La prise de contrôle de certaines villes, les frappes de drones, la famine et la destruction systématique des services essentiels ont caractérisé ce conflit. Presque tous les gens qui ont fui Khartoum sont revenus plus tard pour retrouver leur habitation pillée, voire uniquement les quatre murs qui en restaient.

Lorsque je suis arrivée à Port-Soudan le 3 juin 2025, la ville m’a semblé à la fois familière et étrangère. La chaleur était suffocante, l’air avait le goût du sel, et rien ne me rappelait Khartoum. Mais parmi les membres du personnel, j’ai reconnu quelques visages familiers de mon précédent séjour au Soudan. La vie de ces personnes avait radicalement changé au cours des deux années qui s’étaient écoulées depuis notre dernière rencontre. Presque toutes avaient été déplacées lors des assauts contre Khartoum et d’autres grandes villes en 2023 et 2024. De nombreuses personnes avaient déplacé leur famille dans des pays voisins.
Les histoires qu’on m’a racontées étaient tragiques : fuir sous les tirs, négocier son passage aux postes de contrôle, murmurer des adieux précipités ou s’aventurer jusqu’à la frontière pour mettre ses proches en sécurité. Certaines personnes ont été battues, intimidées, interrogées ou même emprisonnées. Non pas pour ce qu’elles avaient fait, mais parce qu’elles étaient soupçonnées de soutenir un camp ou un autre dans le conflit. Elles ne faisaient toutefois que leur travail en tant que membres du personnel médical. Qu’il s’agisse du personnel chargé du transport ou des médecins, personne n’a été épargné. Chaque histoire illustrait le courage, le deuil et l’épuisement ressentis par celle ou celui qui la racontait.
Quelques semaines plus tard, à la mi-juin 2025, je me suis rendue à Khartoum avec un collègue. Notre première étape, Omdurman, semblait presque calme. Mais le lendemain matin, en traversant le pont, tout a changé. Vidée par la guerre, Khartoum était une ville méconnaissable. Des voitures brûlées bloquaient les routes, les bâtiments étaient criblés de balles et des quartiers entiers étaient plongés dans le silence. Les lieux que j’avais connus autrefois — Afra Mall, Riyad et Khartoum 2 — avaient été complètement défigurés. Même les chats et les chiens errants avaient disparu.

Plus d’un million de personnes seraient revenues dans l’État de Khartoum. Toutefois, la ville n’a plus grand-chose à offrir : réseaux d’eau contaminés, rues jonchées de munitions non explosées, marchés incendiés et services de santé pratiquement inexistants. Les hôpitaux qui constituaient autrefois l’épine dorsale du système de santé ont été détruits, occupés ou abandonnés. Le choléra, la dengue, la rougeole et le paludisme continuent de se propager de manière cyclique. Ces maladies sont alimentées par les déplacements humains, le manque d’eau potable et un système de surveillance des maladies à l’arrêt. La faim aiguë ne cesse de s’aggraver : plus de 20 millions de personnes sont aujourd’hui confrontées à une grave insécurité alimentaire. Le système de santé du pays, déjà fragile avant la guerre, s’est largement effondré et son rétablissement prendra des années.
Le 28 octobre 2025, soit 12 jours après la chute d’El-Fasher, j’ai quitté à nouveau le Soudan, le cœur lourd. Les informations faisant état de massacres, de camps de personnes déplacées incendiés et d’exécutions de personnes civiles continuaient d’affluer. Des atrocités se déroulaient en temps réel, dans un silence ponctué de déclarations de préoccupation répétées. Il est stupéfiant de constater à quel point nous tirons peu d’enseignements de notre histoire. Le monde attend souvent que des atrocités deviennent indéniables et qu’il soit trop tard pour intervenir, avant de réagir à contrecœur, si tant est qu’il le fasse. Alors que les combats s’étendent dans l’État du Kordofan, les gens sont à nouveau pris au piège entre les frappes de drones, les villes assiégées, les maladies et la famine.
Dans cette insistance à garder l’espoir, même au beau milieu des ruines, se cache la résilience qui a permis au Soudan de survivre.
Je n’ai jamais retrouvé mon sac de voyage. Entre les risques de contamination et les restrictions administratives, il m’était impossible de retourner dans l’ancien appartement de MSF. Mes collègues internationaux me taquinaient en disant avoir probablement vu mon écharpe bleue « flotter quelque part » au marché des objets volés de Khartoum. Dans ce marché tentaculaire, les biens pillés, que ce soient des réfrigérateurs ou des vêtements pour enfants, étaient vendus librement pendant la guerre. Mes collègues soudanais, cependant, m’ont exhorté à garder espoir. Loin d’être une intention naïve, il s’agissait d’un souhait sincère à mon égard. Cela reposait sur leur conviction qu’il y avait encore une chance, aussi minime soit-elle.
Je veux leur donner raison. Dans cette insistance à garder l’espoir, même au beau milieu des ruines, se cache la résilience qui a permis au Soudan de survivre. Et peut-être, peut-être seulement, cette guerre pourra prendre fin – si les personnes qui ont le pouvoir de l’arrêter le voulaient vraiment, celles dont les armes, les financements et le silence l’ont entretenue.