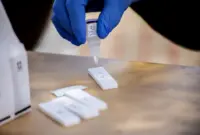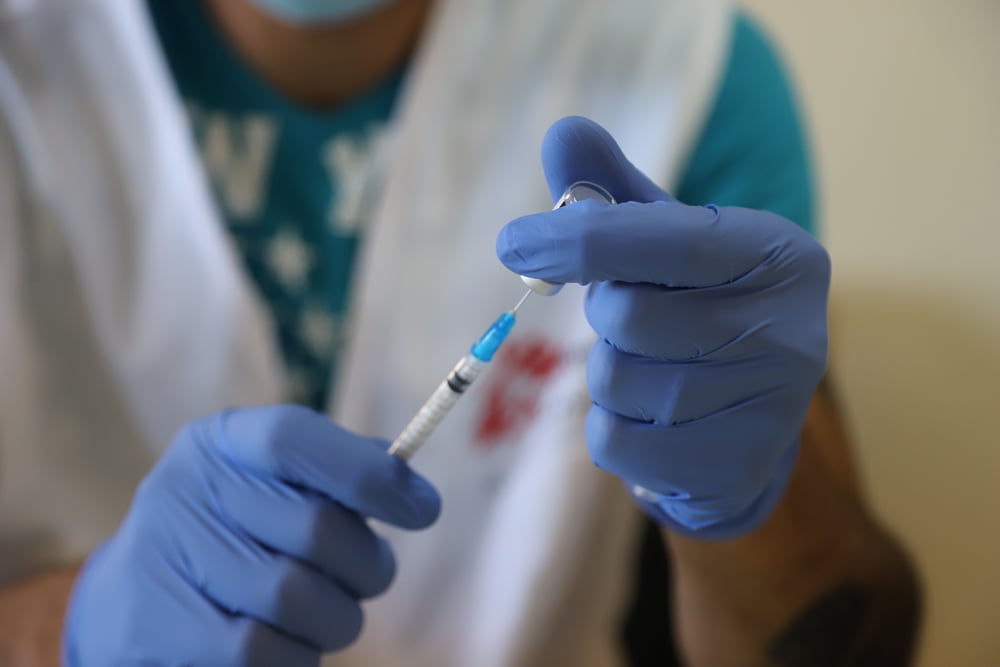Le Canada doit investir pour défendre les principes humanitaires
MSF exhorte le gouvernement canadien à prioriser l'assistance humanitaire dans le budget fédéral.
Existe-t-il un meilleur retour sur investissement que de soutenir les personnes touchées par des crises?
Pour Médecins Sans Frontières (MSF), il s’agit là d’une question fondamentale, alors que nous préparons notre soumission prébudgétaire pour le Comité permanent de la Chambre des communes sur les finances. Ce document qui sera présenté avant que le gouvernement du Canada ne détermine ses priorités pour le budget fédéral de 2026 souligne l’importance de l’assistance humanitaire. Il souligne également la nécessité de veiller à ce que les médicaments et les technologies de la santé soient accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin.
Malheureusement, notre soumission arrive à un moment où de nombreux pays donateurs réduisent les fonds destinés à l’assistance internationale. Les réductions radicales effectuées par les États-Unis et les importantes répercussions qu’elles ont eues ont retenu toute l’attention internationale. Parallèlement, de nombreux pays, dont certains des principaux contributeurs, comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, et d’autres pays, comme la Finlande et les Pays-Bas, ont également réduit leur financement pour l’assistance humanitaire.
Cette situation entraîne, certes, de considérables défis. Elle représente néanmoins une occasion pour le Canada d’affirmer le rôle de leader mondial auquel il aspire, en particulier dans les situations humanitaires où les besoins sont les plus urgents. MSF a d’ailleurs salué l’augmentation des fonds destinés à l’assistance humanitaire prévue dans le budget 2024-2025. Cet effort doit toutefois être renouvelé pour faire face à des besoins croissants auxquels nous devons désormais répondre avec moins de ressources internationales.
Le Canada est depuis longtemps l’un des principaux pays contributeurs à l’assistance internationale. Pourtant, sa contribution n’a jamais été à la hauteur des attentes. Son bilan témoigne en effet d’un écart par rapport à l’objectif approuvé par les Nations Unies, qui consiste à consacrer 0,7 % du produit national brut (PNB) à l’aide publique au développement. Cette somme représente une fraction infime des dépenses globales du pays. Cet objectif de 0,7 % provient d’un rapport publié en 1969 par la Commission sur le développement international, plus connue sous le nom de Pearson Commission. Au cours des cinquante dernières années, seuls quelque pays ont atteint cet objectif, ne serait-ce qu’une seule fois, et jamais de manière constante. Malgré le rôle clé qu’a joué le premier ministre canadien Lester B. Pearson dans l’établissement de cet objectif et les déclarations qui ont suivies quant au rôle du gouvernement canadien sur la scène internationale, le Canada n’a jamais atteint cet objectif du 0,7 %. En fait, le Canada n’a versé, au cours des dernières année, qu’environ la moitié de cette somme.
Le financement humanitaire ne représente qu’une partie de l’aide publique au développement. Toutefois, ce sont ces sommes qui ont les résultats les plus immédiats en termes de nombre de personnes qui reçoivent ainsi une assistance. C’est pourquoi MSF présente une soumission prébudgétaire dans laquelle il demande au Canada de maintenir ou d’augmenter son financement humanitaire par rapport au niveau record de 1,3 milliard de dollars alloué en 2022-2023. Ce financement humanitaire est absolument essentiel pour répondre aux besoins des communautés qui, un peu partout à travers le monde, sont touchées par de graves situations d’urgence, comme des conflits, des déplacements et des catastrophes. Tout retard ou toute réduction du financement coûte des vies.
Les partenariats mondiaux pour la santé, que le Canada soutient depuis longtemps, souffrent également des effets des compressions budgétaires. Il va sans dire que cela a de graves conséquences pour les personnes placées devant les plus grandes situations de vulnérabilité au monde. Prenons l’exemple de Gavi, l’Alliance du Vaccin, qui est un pilier des efforts mondiaux en matière de vaccination. En 2025, d’importants pays donateurs, comme le Royaume-Uni, ont réduit leurs contributions, tandis que les États-Unis ont retiré leur soutien. Certains pays ont heureusement agi à contre-courant. C’est le cas notamment du Canada qui a pris, plus tôt cette année, un engagement important envers Gavi. Même si ces nouveaux engagements ne suffiront pas pour combler entièrement le déficit de financement, ils permettront de soutenir de nombreuses personnes, notamment dans les situations humanitaires où l’accès aux vaccins est essentiel pour prévenir des épidémies potentiellement mortelles.
Avant même d’élaborer son prochain budget fédéral, le Canada pourrait saisir une occasion similaire, dans le cadre du cycle actuel de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Comme le sait très bien MSF, les coupes dans le Fonds mondial auront des conséquences dévastatrices (en anglais seulement). Ils priveront de nombreuses personnes d’un accès à des médicaments essentiels. En 2022, le Canada a pris les devants en augmentant considérablement son financement au Fonds mondial. Il doit faire preuve d’un leadership similaire en 2025.
Cependant, signer des chèques ne suffit pas. Le Canada devrait, par exemple, utiliser son leadership à titre d’important pays donateur et son siège actuel au conseil d’administration du Fonds mondial pour contribuer à façonner le marché des produits achetés par le Fonds mondial. Rendre plus abordables les médicaments et d’autres outils essentiels, comme les tests de diagnostic, contribuera à les rendre accessibles à ceux et celles qui en ont le plus besoin.
Il est vrai que le Canada ne peut, à lui seul, combler tous les déficits de financement. Il peut toutefois utiliser son discernement autant que son portefeuille pour consentir à un investissement canadien d’importance : soutenir les personnes confrontées à des situations de crise